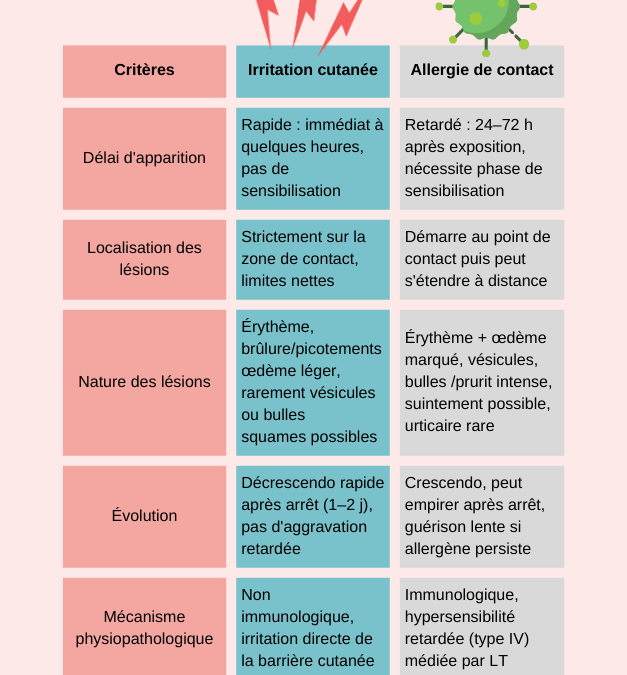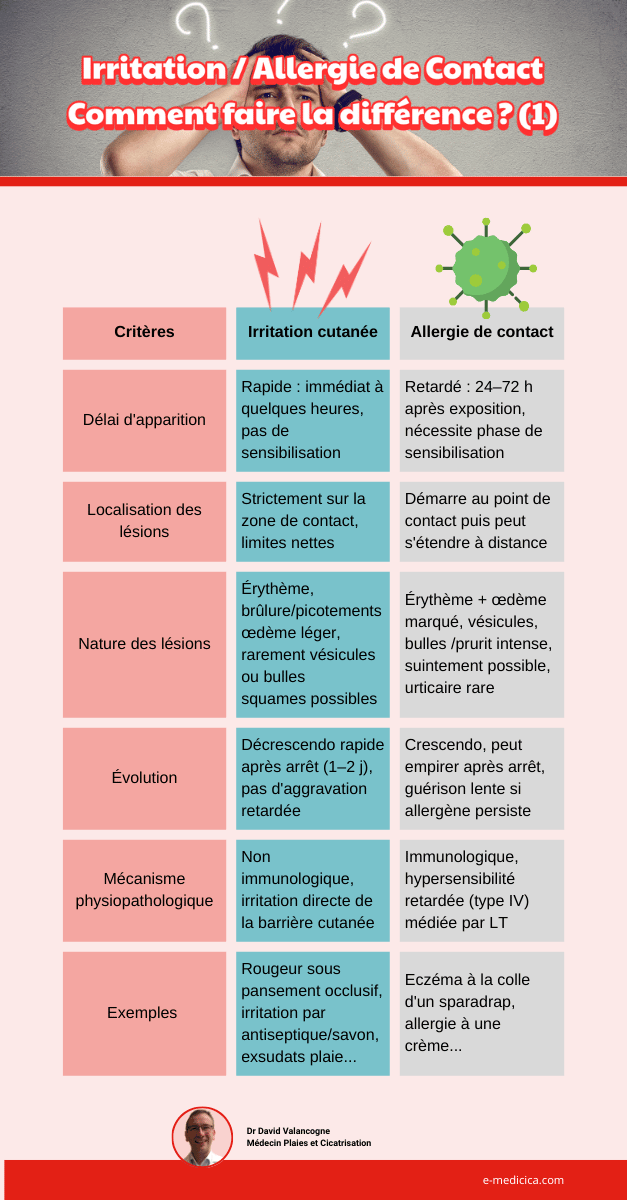Dermite irritative ou allergique : comment et quand tester ?
Pourquoi différencier dermite irritative et allergique ?
Symptômes similaires, causes opposées : l’irritation est une agression directe ; l’allergie, une réaction immunitaire.
Une erreur de diagnostic prolonge la souffrance et ralentit la guérison.
Les tests cutanés pour orienter le diagnostic
Test d’usage
-
Appliqué au pli du coude
-
Produit pur ou dilué, sous film occlusif
-
Surveillance jusqu’à 7 jours
-
Résultat positif = produit incriminé
Limites
-
Ne teste qu’un produit à la fois
-
Ne précise pas l’ingrédient en cause
-
Faux négatifs possibles
Mode d’emploi détaillé du test d’usage
- Nettoyer et sécher le pli du coude
- Appliquer une noisette du produit suspect
- Couvrir avec un pansement transparent (type Tegaderm®)
- Inscrire la date et l’heure
- Laisser poser 4 jours
- Surveiller l’apparition de rougeur ou eczéma jusqu’à J7
Les patch-tests : pour un diagnostic précis
En quoi consistent-ils ?
-
Réalisés par un allergologue ou dermatologue
-
Application d’environ 30 allergènes standards + substances personnalisées
-
Lecture à 48h, 72h, parfois J7
Personnalisation selon le patient
On peut ajouter :
-
Produits personnels : crèmes, pansements, cosmétiques
-
Substances professionnelles : gants, désinfectants, résines
-
Allergènes liés aux loisirs : peinture, bijoux, colles…
Quand orienter vers les patch-tests ?
-
Si le test d’usage est négatif mais les signes persistent
-
Si plusieurs produits sont suspects
-
En contexte professionnel à risque
-
Avant une réexposition thérapeutique
Précautions pratiques à ne pas oublier
-
Toujours dater la pose du test
-
Ne pas négliger les réactions retardées (jusqu’à J7)
-
Assurer un suivi rigoureux des signes cliniques
Conclusion : en cas de doute, testez
Le test d’usage est un outil simple, rapide et accessible.
Les patch-tests permettent un diagnostic plus fin et ciblé.
➡️ Ne restez pas dans le flou : testez, observez, collaborez avec les spécialistes.